L’homme qui veut ouvrir la science urbi et orbi
En 2007, l’Université de Liège a été la première au monde à mettre en libre accès la quasi-totalité de ses publications scientifiques sur sa digithèque ORBi. Derrière cette révolution dans le monde de la recherche : Bernard Rentier, alors recteur de l’établissement belge. Aujourd’hui, il s’interroge sur la manière de généraliser la science ouverte.
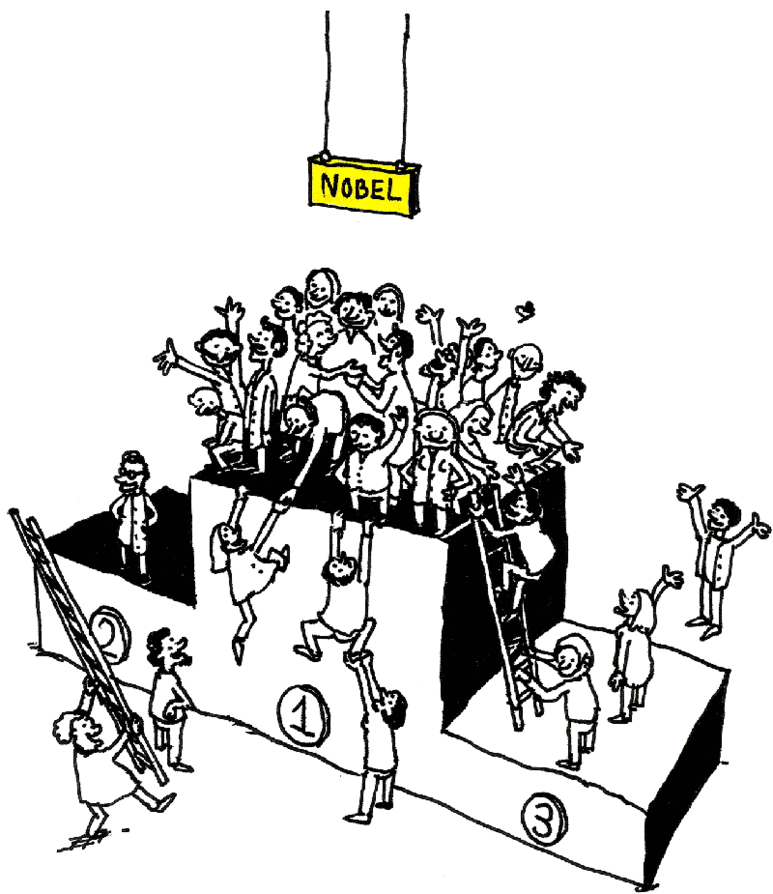
En 2007, Bernard Rentier, alors recteur de l’université belge, a choisi lui-même le nom de cette nouvelle bibliothèque scientifique : ORBi (Open Repository and Bibliography). En latin, orbi veut dire « pour le monde ». Comme s’il fallait annoncer au monde ce nouveau pas d’une grande université européenne en direction de la science ouverte. L’objectif est en tout cas clairement affiché : mettre la production scientifique de l’université à disposition de tous, sans contrainte financière ou technique.
Mais le recteur ne se contente pas d’afficher l’objectif ; il se donne les moyens de l’atteindre. Il impose ORBi aux chercheurs : tout ce qui n’est pas publié sur ORBi n’existe pas aux yeux de l’université. Un article qui n’est pas publié sur ORBi ne peut pas être évalué, puisqu’il n’existe pas. Résultat : onze ans après sa création, 90 % des articles publiés par les chercheurs de l’Université de Liège sont sur ORBi. Et bien sûr, les quelque 200 articles publiés par Bernard Rentier, lui-même, tout au long de sa carrière de chercheur en virologie sont également sur la digithèque.
« En moyenne chaque article publié sur la plateforme est cité 2,5 fois plus qu’avant la création d’ORBi. »
« J’ai manié la carotte et le bâton, reconnait aujourd’hui le recteur en retraite. J’ai fait un matraquage terrible. J’ai préparé la communauté scientifique à cette échéance pendant deux ans. Je ne prononçais pas un discours sans en parler. Quelques années après, plus personne ne souhaiterait revenir en arrière : en moyenne chaque article publié sur la plateforme est cité 2,5 fois plus qu’avant la création d’ORBi. » Dont le succès repose aussi largement sur son bon référencement.
Question d’impact
Mais aujourd’hui, après avoir imposé l’open access à ses confrères liégeois, Bernard Rentier, qui se définit lui-même comme un « extrémiste de la science ouverte », voudrait passer à l’étape suivante : celle de l’open science.
Il le reconnait volontiers : ce sera plus compliqué. « Dans le cas de l’open access, j’avais réussi à convaincre les chercheurs que ça servait leurs intérêts. Dans le cas de l’open science, on parle plus de l’intérêt général que de l’intérêt particulier, or le chercheur pense naturellement d’abord à son intérêt personnel. »
Comment évaluer les travaux de recherche autrement que sur des critères quantitatifs ?
En fait, c’est avant tout la question de l’évaluation des publications qui est posée. « Tant que l’évaluation se fera sur le facteur d’impact des revues scientifiques, on n’avancera pas », regrette Bernard Rentier. Or, le nombre moyen de citations d’articles d’une revue cache souvent la réalité : pour quelques articles cités de très nombreuses fois dans une revue affichant un fort facteur d’impact, beaucoup ne sont quasiment jamais cités. Au contraire, un article publié dans une revue au faible pouvoir d’impact pourra être cité de très nombreuses fois. C’est pourquoi, la communauté scientifique mondiale, lors de la déclaration de San Francisco, en 2013, demandait que le facteur d’impact ne soit plus utilisé pour évaluer les chercheurs.
Évaluation par les pairs
« Malheureusement, regrette l’ancien recteur de l’Université de Liège, la déclaration est peu appliquée : les chercheurs veulent être publiés dans les revues les plus huppées, qui sont aussi les plus chères… » D’accord, mais alors comment évaluer les travaux de recherche autrement que sur des critères quantitatifs ? C’est tout le travail de l’évaluation par les pairs : ils doivent juger l’article sur sa qualité, ses effets sur la recherche, ses avancées. « Mais aussi, insiste l’inventeur d’ORBi, sur le mode de publication : celle-ci a-t-elle été faite en accès libre ? Finalement, l’idée est plus d’encourager le chercheur lui-même que le journal. »
« Pour le chercheur, l’intérêt de l’open science est justement de communiquer aussi sur ses doutes et
ses échecs. »
« Et ce qui pourrait bien faire tourner le vent, c’est l’European Research Council (ERC), se réjouit l’universitaire belge. Il rend obligatoire la publication en accès libre, dès lors qu’une équipe de recherche veut obtenir des subsides européens, les fameux ERC. Selon un raisonnement compréhensible par tous : l’argent public que nous vous donnons doit donner des résultats publics. » Actuellement, université par université, le nombre de chercheurs qui obtiennent des ERC se comptent sur les doigts d’une main : à peine quatre ou cinq pour la seule Université de Liège. Mais c’est, selon Bernard Rentier, la seule méthode pour généraliser l’open science : elle garantit au chercheur que son travail sera reconnu.
Communiquer sur ses échecs
Bernard Rentier se souvient de sa propre expérience : « Alors que j’étais un jeune chercheur, j’avais recherché pendant toute une année les moyens de cultiver un virus. Sans succès. J’avais publié un article pour faire part de mon échec et, lors d’une conférence, communiqué sur le sujet. Des confrères sont venus me voir pour me dire, que si je leur en avais parlé, ils me l’auraient dit tout de suite… Et que donc je n’aurais pas perdu mon année. Morale de l’histoire : pour le chercheur, l’intérêt de l’open science est justement de communiquer aussi sur ses doutes et ses échecs. »

